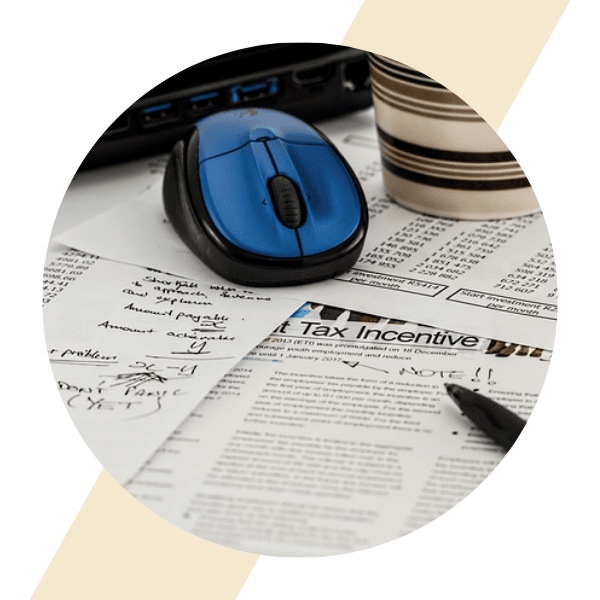Les moyens d’investigation et de contrôle de l’administration fiscale sont extrêmement divers. Pour s’en tenir à l’essentiel, il est possible de citer :
Demandes de renseignements ou de justifications adressées aux contribuables (imprimés 754 et 752) ou verbale (L10 du LPF)
L’administration peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (LPF art. L 10, al. 3).
Le délai accordé aux contribuables pour répondre à de telles demandes est fixé à trente jours à compter de la réception de celles-ci (LPF art. L 11).
Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation aux contribuables de répondre aux demandes, verbales ou écrites, de renseignements.
Par conséquent, le défaut de réponse à une simple demande de renseignements ne peut donc entraîner l’application d’une procédure de taxation particulière ni être sanctionné en tant que tel.
Conséquence de la réponse du contribuable ou du défaut de réponse du contribuable :
Même si ces demandes n’ont pas de caractère contraignant, il est vivement conseillé de répondre afin d’éviter d’être confronté à une mesure plus incisive et plus contraignante.
Demandes d’éclaircissements et de justifications prévues par des textes particuliers
Demande de justifications sur patrimoine immobilier – IFI (article L23 A du LPF)
Dans le cadre du contrôle de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), l’administration fiscale peut adresser au redevable des demandes d’éclaircissements et de justifications sur la composition de son patrimoine immobilier détenu directement ou indirectement.
En effet, l’administration fiscale peut interroger le redevable sur la composition ou valorisation de son patrimoine immobilier, l’existence et l’évaluation des dettes déduites du passif ou encore sur l’éligibilité aux exonérations et réductions d’IFI.
Conséquence de la réponse du contribuable ou du défaut de réponse du contribuable :
En cas de réponse satisfaisante, l’administration ne donne aucune suite à sa demande et le dossier est classé.
En revanche, en cas de non-réponse ou de réponse insuffisante, elle peut :
engager une procédure contradictoire (article L55 du LPF),
écarter le délai de prescription abrégée, passant d’un délai de prescription de 3 ans à 6 ans.
Demande de justifications en matière de contrôle des déclarations de succession et des actes de donation (Article L19 à L21 A du LPF)
Dans le cadre du contrôle des déclarations de succession et des actes de donation, l’administration fiscale peut demander aux héritiers, donataires ou autres ayants droit de fournir des éclaircissements ou des justifications concernant notamment des titres, valeurs mobilières, créances ou biens placés dans un trust.
Conséquence du défaut de réponse du contribuable :
En l’absence de réponse, ou si les éléments fournis sont jugés insuffisants, l’administration adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Les intéressés disposent alors d’un délai de trois mois pour justifier que les biens en question ne faisaient pas partie de la succession ou, à défaut, pour acquitter les droits de mutation correspondants ainsi que les pénalités applicables.
Les demandes spécifiques au contrôle des comptes financiers et des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes établis hors de France (LPF art. L 23 C)
L’administration fiscale peut demander à un contribuable des informations ou des justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs détenus sur des comptes bancaires ou des contrats d’assurance-vie souscrits à l’étranger, dès lors qu’il n’a pas respecté, au cours des dix dernières années, ses obligations déclaratives relatives à ces avoirs.
Cette procédure s’applique dans les mêmes conditions aux contrats d’assurance-vie non déclarés conformément à l’article 1649 AA du Code général des impôts (CGI).
Conséquence du défaut de réponse du contribuable :
Lorsque le contribuable ne répond pas dans un délai de soixante jours, ou lorsque sa réponse s’avère insuffisante, l’administration lui adresse une mise en demeure. Cette dernière l’invite à apporter des précisions complémentairesdans un nouveau délai de trente jours.
À défaut de réponse dans les délais impartis, ou en cas de réponse encore insuffisante, l’administration considère que les avoirs concernés ont été reçus à titre gratuit.
Dans ce cas, elle applique alors une taxation d’office aux droits de mutation à titre gratuit, au taux de 60 %, applicable aux transmissions entre personnes non parentes (LPF art. L 71 et CGI art. 755).
La base d’imposition correspond à la valeur la plus élevée connue du compte ou du contrat au cours des dix années précédant la demande, diminuée de la valeur des avoirs dûment justifiés.
Demandes d’éclaircissements et de justifications en matière d’impôt sur le revenu (article L. 16 du LPF)
Si des incohérences sont relevées, l’administration peut demander à un contribuable de produire des éclaircissements ou des justificatifs.
L’administration fiscale peut demander à un contribuable :
des éclaircissements d’une part: informations ou commentaires sur des éléments déjà déclarés,
ou des justifications d’autre part : documents prouvant certains postes (situation familiale, charges déduites, revenus fonciers, plus-values, etc.).
Ces demandes se distinguent des simples demandes de renseignements. Elles visent les mentions portées sur les déclarations de revenus souscrites par le contribuable.
Toutefois, si l’administration fiscale dispose d’indices laissant penser que le contribuable a sous-évalué ses revenus, elle peut exiger des justificatifs plus larges.
Conséquence du défaut de réponse du contribuable :
En l’absence de réponse ou si celle-ci est insuffisante, le contribuable s’expose à une taxation d’office.
Droit de communication (article L. 81 du LPF)
Le droit de communication permet à l’administration fiscale d’obtenir, directement auprès de tiers (banques, notaires, organismes sociaux, partenaires commerciaux…), des documents utiles pour vérifier l’assiette des impôts.
Ce droit de communication ne peut être exercé qu’auprès de certaines catégories de personnes limitativement énumérées par la loi.
Conséquence du refus de communication des documents et renseignements :
Conformément à l’article 1734 du code général des impôts, le refus de communication des documents et renseignements demandés par l’administration dans l’exercice de son droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la communication entraîne l’application d’une amende de 10 000 €.
Droit d’enquête et perquisitions fiscales (article L. 16 B du LPF)
Lorsqu’elle dispose d’indices graves et concordants laissant présumer une fraude, l’administration fiscale peut solliciter du juge des libertés et de la détention l’autorisation de mener une visite domiciliaire, communément appelée « perquisition fiscale ».
Concrètement, cette procédure exceptionnelle, strictement encadrée, s’exerce sous l’autorité et le contrôle du juge. Elle permet à l’administration :
de se rendre en tout lieu, y compris au domicile privé du contribuable ou dans les locaux professionnels,
et de saisir tout document ou support de nature à établir l’existence d’une fraude fiscale.
Ce droit d’enquête constitue un levier puissant dans la lutte contre la fraude fiscale organisée ou dissimulée.
Échanges internationaux d’informations et renseignements
Dans le cadre de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, l’administration fiscale française bénéficie de mécanismes internationaux de coopération lui permettant d’accéder à des données financières concernant des contribuables domiciliés ou disposant d’avoirs à l’étranger.
Tout d’abord, ces échanges sont encadrés par la directive 2011/16/UE, qui organise la coopération administrative entre les États membres de l’Union européenne. Cette directive prévoit des échanges d’informations sur demande, mais aussi spontanés ou automatiques, via un système électronique sécurisé.
Ensuite, au niveau mondial, l’article 26 du modèle de convention de l’OCDE autorise l’échange d’informations fiscales dites « vraisemblablement pertinentes ». Ce dispositif est particulièrement puissant car il permet des transmissions même sans identification nominative et sans possibilité d’opposer le secret bancaire.
Par ailleurs, de nombreuses conventions bilatérales et multilatérales signées par la France prévoient une assistance administrative mutuelle en matière fiscale, venant ainsi compléter l’arsenal conventionnel disponible.
En pratique, ces instruments permettent à l’administration fiscale :
d’identifier des avoirs détenus à l’étranger (comptes bancaires, contrats d’assurance-vie, biens immobiliers, etc.) ;
et de croiser ces informations avec les déclarations effectuées par les contribuables français.
Ces échanges internationaux jouent donc un rôle central dans la détection des situations à risque et le déclenchement de procédures de contrôle ou de redressement.
Police fiscale et flagrance fiscale
Dans les cas les plus graves, notamment en présence de fraude fiscale aggravée, l’administration peut recourir à des dispositifs d’enquête pénale renforcée.
Ainsi, elle peut faire appel à la police fiscale, une unité spécialisée placée sous l’autorité du procureur de la République, pour conduire des investigations pénales approfondies.
De plus, lorsque des faits constitutifs d’une fraude sont constatés en flagrance, notamment lors d’une intervention sur place, l’administration peut déclencher la procédure de flagrance fiscale prévue à l’article L. 16-0 BA du Livre des procédures fiscales.
Enfin, l’article L. 10-0 AB du LPF reconnaît à l’administration un pouvoir d’audition spécifique, permettant de recueillir des informations utiles à la lutte contre la fraude fiscale internationale.
Nouveaux outils numériques d’investigation
Parallèlement aux contrôles classiques, l’administration fiscale mobilise activement les technologies numériques pour renforcer l’efficacité de ses vérifications. Ces outils lui permettent non seulement de repérer les incohérences, mais aussi de mieux cibler les contribuables à risque et d’optimiser ses actions de contrôle.
Concrètement, elle utilise plusieurs dispositifs :
Tout d’abord, Évafisc : ce fichier centralise les comptes bancaires ouverts à l’étranger par des personnes physiques ou morales. L’administration exploite ces informations pour vérifier la cohérence des déclarations et déceler les éventuelles omissions.
Ensuite, Tracfin : ce service de renseignement financier collecte et traite des données relatives au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme, ainsi qu’à la fraude fiscale, sociale et douanière. Sur la base de ses signalements, l’administration fiscale peut déclencher des contrôles ciblés.
En outre, les sources accessibles en ligne : les agents peuvent consulter les réseaux sociaux, les plateformes collaboratives ou les sites d’annonces. Ils cherchent ainsi à identifier des informations publiques susceptibles de mettre en cause la véracité des déclarations fiscales.
Par ailleurs, les enquêtes sous pseudonyme : les services fiscaux sont autorisés à naviguer anonymement sur internet, par exemple pour constater une location saisonnière non déclarée ou des ventes répétées de biens.
Enfin, l’analyse automatisée de données (Big Data et intelligence artificielle) : l’administration analyse à grande échelle des volumes massifs d’informations. Cette exploitation algorithmique lui permet de détecter rapidement des anomalies, de repérer des profils à risque ou de reconstituer des schémas de fraude sophistiqués.
En résumé, ces outils numériques permettent à l’administration de mieux anticiper les manquements, d’agir plus rapidement et de compléter ses méthodes traditionnelles de contrôle.
.